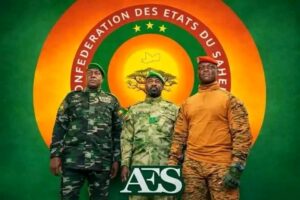Le coton, souvent présenté comme « l’or blanc » du Tchad, traverse une crise sans précédent. La campagne agricole 2024/2025 s’achève sur une note alarmante : la production nationale s’établit à 57 774 tonnes, contre 111 262 tonnes l’année précédente, soit une baisse de près de 48 %, selon les données du Programme régional de production intégrée du coton en Afrique (PR-PICA).
Cette forte chute trouve son origine dans plusieurs facteurs. D’abord, les rendements ont considérablement reculé, passant de 574 kg/ha à seulement 424 kg/ha. Ensuite, la surface cultivée a été réduite de près de 30 %, conséquence directe d’une faible mobilisation des producteurs, découragés par la hausse des coûts de production, le manque d’intrants et les retards dans leur distribution.
Selon nos confrères d’Ecomatin, cette contre-performance est la plus faible enregistrée depuis quatre ans, et compromet sérieusement les ambitions de relance de la filière cotonnière. En effet, CotonTchad SN, unique opérateur du secteur, espérait dépasser les 150 000 tonnes cette saison — un objectif désormais hors d’atteinte.
La crise climatique a également accentué la dégringolade : la pluviométrie a été en deçà des moyennes saisonnières, retardant les semis et affectant la croissance des plants. À cela s’ajoute l’impact de l’exode rural, qui vide les campagnes de leur main-d’œuvre jeune, et des incursions animales ayant ravagé certaines exploitations.
Sur le plan économique, la chute de la production aura des répercussions notables sur les recettes d’exportation. Le coton représente, avec la gomme arabique, une source essentielle de devises pour le pays. En 2022, le Tchad avait engrangé plus de 18 milliards FCFA grâce aux exportations de coton brut. La saison actuelle laisse présager un sérieux manque à gagner pour les finances publiques.
Toujours selon Ecomatin, cette contre-performance pourrait affecter l’ensemble de la zone CEMAC, dont le Tchad est l’un des principaux producteurs. La baisse attendue des volumes exportables risque d’impacter négativement la balance commerciale sous-régionale.
Alors que le pays s’engage dans une stratégie de modernisation agricole à l’horizon 2030, cette campagne apparaît comme un signal d’alerte. Il y a urgence à repenser la filière, à sécuriser les approvisionnements en intrants et à intégrer davantage les enjeux climatiques dans la planification agricole.
Raphaël Bassami